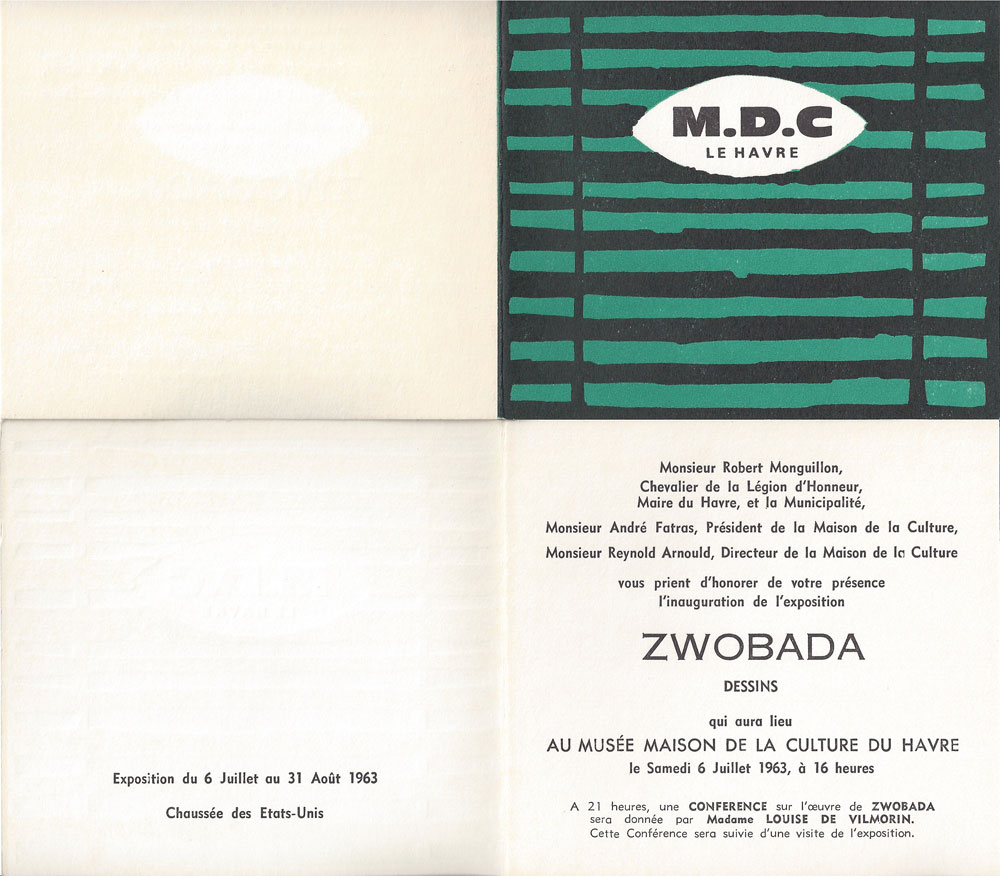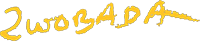Hommage
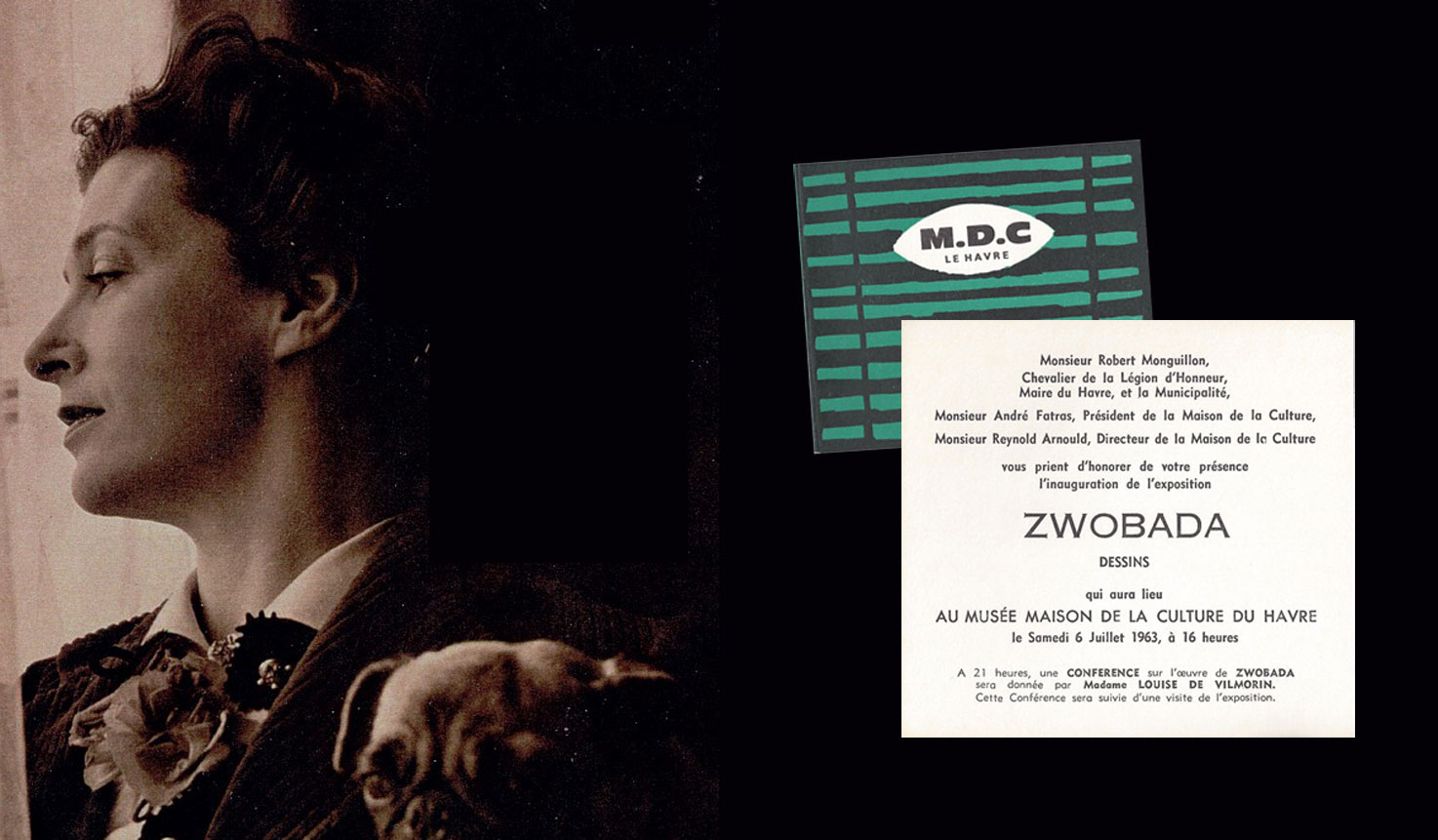
JACQUES ZWOBADA VU PAR LOUISE DE VILMORIN
CAUSERIE
Faite par Madame Louise de Vilmorin
Au Musée Maison de la Culture du Havre à l’occasion de l’exposition de
Dessins de JACQUES ZWOBADA
Le 6 juillet 1963
Les grands artistes sont des précurseurs et des visionnaires, mais il est difficile de connaître les effets de leur vocation sur leur existence si l’on n’en a pas été le témoin. Pour la plupart c’est une révélation soudaine, c’est une voix qui ordonne et à laquelle ils obéiront. Leur vie d’un seul coup est bouleversée. C’est ce qui advint à Jacques Zwobada un jour de printemps 1917, lorsqu’il avait 17 ans puisqu’il est né avec le siècle ; son aventure commençait et cette aventure ressemble à celle des héros des contes des fées qui pour atteindre l’objet de leur rêve doivent traverser de multiples épreuves, endurer de nombreuses angoisses et affronter des dangers incessants.
Jacques Zwobada n’ignorait pas les difficultés qu’il allait rencontrer car l’exemple des illustres compositeurs que connaissaient ses parents lui permettait de deviner les revers de la vie d’artiste et les déceptions qu’éprouve toute nature intransigeante et sincère en comparant son œuvre à l’idéal qu’il a en lui. Mais l’appel était trop fort et, sans se détourner de ses parents auxquels un tendre attachement ne cessa de le lier, il se lança avec un résolution passionnée, sans technique ni maître, dans le dessin. Par l’observation et l ‘étude de la nature ce dessin devait plus tard devenir un art à la fois inventé, imité, révolutionnaire et classique. Il était libre enfin d’en faire à sa tête car, jusqu’alors, sa vie avait davantage été marquée par le confort que par l’indépendance, mais sa tendance à la paresse avait été si bien combattue par la fermeté de sa mère qu’elle s’était transformée en discipline de travail. Toute sa vie devait en bénéficier.
Au jour du grand choix, Jacques Zwobada n’eut pas à rompre avec les siens et à s’élancer, seul, sur le chemin qui l’aurait conduit au Saint-Germain-des-Prés de l’époque. Non, il continua à vivre avec sa famille dans le pavillon de Neuilly où, jusqu’à la mort de son père, il eut la chance de pouvoir échapper aux préoccupations matérielles grâce à la générosité de son père, à sa bienveillance et à son intérêt pour les arts.
Des longues conversations que j’ai eues avec jacques Zwobada, j’ai conclu que durant cette période s’est forgé en lui cette rigueur à l’égard de sa propre expression plastique, « Pourquoi ferais-je des concessions ? quelle excuse aurais-je à me satisfaire du médiocre puisque le temps ne m’est pas compté, que les besoins ne me pressent pas ? »
Il était lent, il le savait, mais il était certain d’avancer. Souvent, les grandes choses se bâtissent à petite allure et l’artiste, malgré son impatience à prouver son génie, ressent déjà une griserie sans pareille lorsqu’il a réussi à transmettre un peu de son sentiment original dans un dessin, dans un morceau de dessin, ne serait-ce que dans une ligne.
Lui, qui avait l’ambition des dieux et l’obstination des bêtes, a toujours trouvé en lui la force de surmonter les crises que traverse tout créateur devant l’évidence de l’inaccessibilité de son idéal.
Il n’était pas superflu de placer pour vous l’artiste dans le cadre de sa vie afin de l’accompagner sur la voie qu’il suivit avant et après sa révélation.
La famille de Jacques Zwobada mérite, aujourd’hui, d’être expliquée non pas en raison de sa lointaine origine tchèque d’où provient ce nom qui signifie « Liberté », car cela n’a rien d’exceptionnel dans notre pays où les étrangers ont toujours été reçu et assimilés jusqu’à devenir des gloires françaises. Ce qu’on doit dire de cette famille c’est qu’elle appartenait au groupe de bourgeois dont parlent Zola et Maupassant, qui sont aisés parce qu’ils travaillent mais n’ont pas, pour cela, été corrompus par le culte de l’argent. Chez eux, les principes et la rigueur morale étaient empreints de bonne humeur, de libéralisme, d’esprit social pour ne pas dire révolutionnaire, du goût de la musique et de la littérature.
Entouré de ses parents, de ses deux frères et de sa sœur, il vécut 30 ans à Neuilly, dans une maison qu’un jardinet reliait aux magasins et bureaux de l’entreprise de peinture que possédait et dirigeait son père.
Ce père me paraît ressembler à Jacques Zwobada par plus d’un côté : par son libéralisme, son sérieux dans le travail, son plaisir à être gai, sa considération des sentiments d’autrui, par la noblesse de son abord humain et sa façon de parler des grandes choses sans employer de grands mots et de se faire ainsi comprendre de tout auditoire.
Pendant ses onze premières années, enfant malingre et maladif, il fut un piteux élève, sans intérêt pour les études qu’il suivait avec deux ans de retard sur ses camarades. Aussi souvent qu’à l’école communale ou au lycée, il restait à la maison, soumis à l’autorité de sa mère et transporté aussi dans le monde de l’imagination, de l’enchantement et de la magie par les récits de sa grand’mère qu’il ne se lassait pas d’écouter. Ses propos, la douceur de sa voix et de son visage ont si profondément marqué l’esprit de l’enfant qu’aujourd’hui encore il s’efforce de transposer dans les formes leur réalité sensible.
Aussi, son intelligence fermée à la logique et aux raisonnements, sans mémoire pour la grammaire et le solfège, sans goût pour les mathématiques lui fit-elle traverser son enfance et son adolescence dans une grisaille indistincte d’où n’émergent que des visages, des récits et des sourires. Il était heureux sans doute, puisqu’il n’était pas malheureux, protégé contre le malheur par les soins monotones et prévoyants de la routine.
Mais ce qui n’est plus la routine, c’est ce fameux jour de mars 1917, pendant les vacances de Pâques, où le choix du sens de sa vie fut enlevé par la découverte de son destin.
Résolu à se consacrer au dessin il en fit l’aveu à M. Adam qui professait cette discipline au Lycée pasteur. Celui-ci non seulement ne l’encouragea pas, mais encore alla trouver son père pour lui expliquer les raisons de combattre une idée aussi saugrenue. Il est évident qu’un tel maître ne pouvait concevoir l’avenir d’un garçon dans une spécialité où il manifestait une indépendance qui selon lui était dangereuse. Croyant détenir la recette de cette science, M. Adam ne voyait que déboires pour celui qui s’en écarterait.
Cela me rappelle certains propos que Jacques Zwobada m’a tenus il y a longtemps, au sujet de l’enseignement. Il me disait : « Lorsque l’on remarque dans un dessin d ‘élève un élément qui ne va pas avec le reste, soit hors de proportion, soit comme dessiné par une autre main, il faut souvent le respecter et non, ainsi que l’exigent certains professeurs, le faire effacer et remplacer par des rapports platement conventionnels. Au contraire, si le détail montre une vision personnelle, une force et un tempérament, on doit conseiller à l ‘élève de corriger tout le reste et de construire l’ensemble en prenant ce morceau pour base. Un professeur doit savoir respecter l’originalité d’un caractère et distinguer de ce qui, chez les esprits médiocres, n’est qu’une excentricité délibérée, une sorte de preuve d’impuissance. Il faut décourager ceci, encourager cela et aider l’homme à se révéler ».
Retardé dans sa carrière par ce professeur, notre homme fut obligé pendant un an encore, de ronger son frein et de poursuivre au lycée des études incompréhensibles et décourageantes. Lorsque l’appel de son art fut trop fort, c’est vers son père qu’il se tourna. Il lui parla de sa vocation, de son espoir et de sa volonté de dessiner et c’est alors que ce bourgeois, ce chef d’entreprise qui aurait été en droit d’exiger que son fils le seconde dans ses affaires et lui emboîte le pas, « montra ce qu’il était », comme dit la Fontaine, et poussa son fils vers un avenir hasardeux, incertain et glorieux.
Je vois la grandeur chez ce père de 40 ans qui n’hésite pas à favoriser la carrière artistique d’un garçon qui lui demande d’abandonner ses études pour se jeter dans l’inconnu dont il prétendra apprendre, seul, à connaître les règles et les principes. Ce fils avait su lui faire comprendre les émotions éprouvées au contact de ce monde nouveau, plein de sensations exaltantes. Malgré son inexpérience te son inhabilité, sa main exigeait de dessiner, de placer sur l’éclat du papier les formes qui en modulaient la lumière, et cet exercice l’enivrait malgré les défauts qu’il remarquait et qui, loin de le décourager, étaient pour lui comme un stimulant et il s’acharnait à travailler pour en devenir maître. Ce plaisir physique dominait son existence et, toute la journée, les croquis succédaient aux études, les visages aux nus et les paysages, si bien que petit à petit, il se forgea un métier qui, en réalité, était une écriture par laquelle il parvint à libérer des richesses intérieures qui demandaient à vivre.
Cette époque de sa vie paraît capitale pour toute son œuvre. Sa ténacité ne s’exerçait que sur le dessin et, devenu sculpteur il n’a jamais abandonné l’idée que le dessin était une fois en soi et non pas un moyen. Il l’a toujours considéré comme un art indépendant de la sculpture et de la peinture.
Donc pendant cette année décisive, Jacques Zwobada ne quittait ni son crayon ni son papier et travaillait en rêvant de pouvoir, un jour, créer avec ses seuls et fragiles moyens, une œuvre qui s’élèverait au rang des grandes impressions plastiques.
Malgré le séduisant romantisme de l’image, ce serait un mensonge que de dire qu’il était seul, face à sa destinée de créateur. S’il fut un autodidacte en ce qui concerne la découverte de son métier et de son graphisme, il avait pour parler de l’Art, et en entendre parler, un interlocuteur comme peu d’artiste ont eu la chance d’en avoir : André Caplet est le véritable maître spirituel de Jacques Zwobada. Compositeur, chef d’orchestre et pianiste, cet ami enfance de la famille eu sur lui une forte et bénéfique influence que j’attribue à la combinaison de deux qualités dignes d’inspirer l’admiration et le respect : il avait, à la fois, le talent et la probité, et ce sont des traits, plus encore que sa notoriété et son succès, qui firent de lui l’oracle dont les jugements et les avis ont, sans appel, orienté l’existence du débutant.
Je ne résiste pas au désir de vous raconte une scène que je tiens de la bouche même de Jacques Zwobada et qui se situe dans les premiers temps de ses recherches plastiques. À cette époque, chaque fois qu’un dessin lui semblait présenter quelques qualités, il l’apportait à André Caplet afin d’entendre ses critiques et de progresser ainsi sur la voie de ses intentions. Capelet lui disait : « Tu sais ce qui est bien, parlons de ce qui est mauvais », et inlassablement, commençait l’œuvre dont il mettait en évidence les imperfections, mais de longtemps il n’eut pas l’occasion de faire à l’auteur le moindre compliment. Et puis, un beau jour, Jacques Zwobada lui soumit un dessin qui lui plut. Il s’agissait d’un visage dans lequel la sensibilité de l’artiste apparaissait dans une vision originale et pénétrante du sujet. Avec la même probité qui lui avait fait critiquer ce qui ne lui plaisait pas, il félicita son jeune ami de cette première œuvre où perçait son tempérament. On peut facilement imaginer les sentiments qui agitèrent Jacques Zwobada. Encouragé par la certitude d’avoir mis au point le processus à fabriquer les chefs-d’œuvre, il retourna vivement à son atelier, se remit au travail et, dans une fièvre d’optimisme fit un nouveau portrait qu’il jugea encore plus digne encore de l’admiration de son conseiller. Le cœur battant, il courut chez lui le lendemain et le lui montra. Hélas ! Il n’entendit ni louanges ni même de critiques ! Caplet jeta un coup d’œil sur le dessin et le lui rendit avec cette simple phrase : « Tu me l’as déjà montré hier, c’est le même ».
Ces mots, qui contenaient un avertissement le frappèrent et restèrent pour toujours gravés dans son esprit. Il comprit qu’en art il ne s’agit ni de « truc » ni de « ronron » et que l’habileté, ennemie du renouvellement entraîne l’artiste à se répéter, à refaire sans cesse et comme malgré lui, la même chose quel que soit le sujet qu’il traite. De ce jour, Jacques Zwobada se donna pour but de se dépasser. Depuis lors, combien de fois ne l’ai-je pas vu abandonner ou détruire sans regret ni colère un dessin qui lui avait valu des dizaines d’heures de travail : « Je n’avance pas, j’ai déjà dit cela » me disait-il.
Sans doute André Caplet lui rendit-il un autre service inestimable. En effet, après ces premiers mois consacrés au dessin et à la méditation sur sa propre vision des formes, Jacques Zwobada voulut prendre les conseils d’un ancien professeur qu’il avait eu au Lycée Carnot et dans l’atelier duquel il pensait pouvoir travailler. Ce professeur était un sculpteur médiocre, à l’inspiration superficielle, plutôt imitative des effets faciles sans même avoir l’excuse de la frivolité. Lors de sa première visite à cet atelier, André Caplet explosa d’indignation et interdit à Jacques Zwobada, qui n’était pas encore capable de discerner le bien du mal, de rester un jour de plus dans ce lieu de perdition. Il lui dit qu’il se devait de respecter l’Art auquel il voulait se consacrer et que son ambition ne devait résider que dans le désir d’en atteindre les plus hauts sommets.
André Caplet savait que, pour une nature sensuelle comme celle de Jacques Zwobada, le modelage pouvait engendrer des joies pernicieuses qui égareraient son esprit et sa sensibilité jusqu’à les perdre dans la stérilité du faux talent. Il voulait que Jacques Zwobada mit son inspiration à l’écart de la vulgarité et son intervention fut, en quelque sorte, prophétique car elle permit, peu après, à l’artiste d’éprouver le grand choc de sa vie en découvrant Rodin.
On n’imagine ce jeune homme, sans préjugés et sans snobisme de groupe, entrant par hasard au musée qui occupait alors l’Orangerie du Luxembourg, lieu où l’on mettait les œuvres modernes en attendant que la postérité ait décidé de leur valeur. Il errait, indifférent dans ce qu’il appelle « la nécropole des habiletés sans âme », lorsque soudain, il se trouva devant deux sculptures de Rodin : l’âge d’airain et l’Homme qui marche. Frappé d’admiration, d’hébétude, de surprise et d’émotion, il s’assit et regarda. Et voici que plus il regardait, plus l’émotion grandissait en lui devant le mystère de l’œuvre d’art et de sa création, c’est à dire devant la découverte de l’existence d’un monde plastique qui dépasse la simple représentation du corps humain et puise à une autre source sa signification et sa réalité. Il voyait, d’un seul coup, s’écrouler tout le conformisme rassurant, sans en être autrement touché car il n’en avait jamais eu que faire et que, d’ailleurs, son tempérament ne le poussait pas vers la sécurité. Cependant, quoique plongé dans la griserie de cette tempête d’admiration qui emportait son âme lyrique, il sentait bien que le génie devient un sorcier lorsqu’il réussit à mettre le mouvement dans l’immobilité, ou plutôt, à animer l’équilibre des forces dans l’immobilité de la pesanteur. Pour la première fois, il comprit qu’il existe dans toutes choses et au-delà d’elles, un élément mystérieux qu’aucune habileté de métier ne peut révéler si l’artiste n’est pas, à chaque instant, préoccupé des rapports du visible et de l’invisible, s’il n’accepte pas le risque d’affronter le désespoir dans ses tentatives d’exprimer ensemble l’Homme et son Univers.
Rappelons que Jacques Zwobada n’en était encore qu’au début de sa carrière. Pour moi, le signe de sa prédestination ne réside pas tant dans la passion exclusive et irraisonnée qu’il éprouve pour son art que dans sa compréhension intime et directe des chefs-d’œuvre. La leçon qu’il en reçoit éveille en lui le désir de travailler et de travailler afin de faire, lui aussi, une œuvre qui, à travers les siècles, dira sa vision et fera éprouver à d’autres des moments analogues à ceux qu’il a connus dans sa contemplation sensible.
Lancé à corps perdu dans un monde vu par Rodin, il ne tarda pas à s’apercevoir que leurs tempéraments s’opposaient malgré leur point commun. Et il ne cessa bientôt de s’en inspirer sans jamais lui retirer son admiration. En dix ans leur point commun, je parle au singulier car si l’on trouve le même lyrisme du mouvement chez Rodin et chez Jacques Zwobada, il faut limiter là leur rapport mis à part les effets tactiles résultant de l’extase qu’il éprouva de leur première rencontre. À présent encore il regrette de ne pas avoir connu Rodin qui, à l’époque, venait de mourir. On devine ce qu’auraient pu être son exemple et les questions posées, et surtout, l’on voit en pensée comment dans l’atelier, Jacques Zwobada aurait regardé les mains du maître animer la matière. Car les plus belles explications verbales, si justes et précieuses soient-elles, ne peuvent remplacer la valeur exemplaire du geste créateur. Seule la main peut illustrer sans réserve, dans sa simplicité autoritaire, les lois secrètes qui décident de la place des choses. En parler est, certes, intéressant, exaltant, rassurant. On échange ses convictions : il faut établir le mouvement d’une statue par l’accentuation des grands plans ; il faut équilibrer les pleins et les vides, l’étendue des surfaces ; il faut déterminer la plénitude des volumes en les limitant par des fonds soustraits à la lumière ; il faut moduler les passages ; il faut… il faut… mais au moment de le faire, on ne sait comment s’y prendre et l’on ressent combien la vue du geste d’une main aurait pu vous aider à franchir un pas, puis un autre, alors qu’il vous faudra, seul, redécouvrir tous ces secrets.
Il fut donc influencé par Rodin et il cessa de l’être.
Il fut ensuite influencé par Bourdelle, et il cessa de l’être.
Il fut aussi influencé par Despiau et il cessa de l’être.
Et puis il fut influencé par bien d’autres jusqu’à ce qu’il ait trouvé sa forme définitive.
La marque certaine des esprits originaux est de ne pas craindre de laisser l’œuvre d’autrui marquer leur propre création, mais de s’en dégager dès lors qu’ils s’aperçoivent que leur vision personnelle a besoin de moyens plus originaux qui n’existent pas, préfabriqués, dans les musées. Jacques Zwobada assista donc, stoïques, à ces divers épisodes de sa sculpture, mais il n’en fut pas de même pour son dessin qui a toujours suivi le fil de sa propre destinée ; qui a échappé aux concessions comme aux influences ; qui a été tracé par une main que ne guida aucune autre main. Toutefois, malgré cette différence fondamentale, on ne peut pas le séparer de sa sculpture parce que, si leurs moyens sont fort différents, si le dessin avait déjà trouvé son style tandis que la sculpture le cherchait encore, il n’en reste pas moins que l’objectif plastique, le sentiment de l’artiste sont les mêmes dans les deux.
Il arrivera à Jacques Zwobada d’abandonner la sculpture pendant près de huit ans et de ne travailler qu’à des dessins, mais quand il réussira enfin à se trouver lui-même dans sa forme, la sculpture et le dessin prirent, sans difficulté, leur place sous sa main.
De 1918 à 1939, il fut ainsi déchiré et les œuvres de cette époque qui seront exposées jusqu’au 30 septembre dans le Musée du Havre (maison de la Culture) en portent la trace de façon évidente.
La façon dont il était tiraillé par les diverses tendances qui l’habitaient est assez bien illustrée par le monument à la mémoire d’André Caplet qu’on lui commanda aussitôt après la mort du compositeur, en 1925, et qu’il exécuta l’année suivante. Il s’agissait d’un ensemble assez vaste et l’artiste se trouva devant un problème de composition difficile à résoudre. Il plaça son monument dans la pièce d’eau du jardin de Saint-Roch. Ce monument comprenait une lyre flanquée de deux allégoriques de la musique religieuse et profane. Elles étaient symbolisées par des statues inspirées et dans le style, la première de l’Aurige de Delphes, et la seconde de la Reine du portail de Chartres.
André Caplet est l’une des gloires de la ville du Havre et, il y a maintenant 30 ans, ce monument fut inauguré avant d’être détruit 10 ans plus tard par les bombardements. Voici que j’en parle à l’occasion de l’exposition qui a lieu, au Havre, des dessins de Jacques Zwobada. Il semble donc que cette ville se plaise à mêler les destinées si proches et si diverses de ces deux artistes.
En 1930, par amitié posthume, Jacques Zwobada décida d’illustrer le « Miroir de Jésus » dont André Caplet avait fait la musique sur un texte de Ghéon. Les dessins sont fort intéressants et retrouvent, pour illustrer cette œuvre religieuse, un peu de l’esprit des primitifs. Ils marquent surtout, à mon avis, les progrès de l’auteur dans la découverte des grands principes de l’organisation d’une surface.
Tout cela montre la naïveté de l’homme sincère qui n’a pas encore trouvé le difficile équilibre d’un tempérament trop volontaire pour se contenter du médiocre et qui cherche comment mériter ses dons. Un incident de sa vie illustre ce désarroi. Il avait, au cours de ces années, épousé une femme et je n’ai pu lui arracher d’autre raison à ce mariage que le fait qu’elle ressemblait à la reine du portail de Chartres, laquelle avait fait partie de l’olympe de son esthétique. Ce mariage, du reste, ne fut qu’un épisode.
Son père mourut en 1930 et, avec lui, disparut le soutien qui simplifiait si bien les choses. Elles s’arrangèrent cependant car il y eut, la même année, un concours international pour élever une statue à Simon Bolivar dans la ville de Quito. C’était un ensemble important – figure équestre et bas-reliefs. – et il dut déployer de sérieux efforts pour la mise au point du projet. Il obtint le premier prix devant de nombreux candidats de toutes les nations et, avec son camarade Letourneur, se consacra pendant deux ans à l’exécution de cette grandiose statue.
Hélas, ce succès, quelque considérable qu’il fut, ne lui apporta pas la paix qu’engendre la satisfaction. Pendant la durée du travail, il n’avait pas eu le temps de se poser trop de questions mais, aussitôt libéré, il fit le bilan artistique de ses efforts et sombra dans une sorte de crise de désespoir qui l’aurait fait douter de tout s’il n’avait pas eu le dessin pour conserver un sens à sa vie.
Il eut la modestie de remettre en chantier les bases mêmes de son expression et pour découvrir son langage il accepta d’enseigner le dessin. Ne voyez pas un paradoxe là-dedans. Tous les bons esprits, ceux que la vanité n’aveugle pas, reconnaissent que le professorat est enrichissant puisqu’il impose d’approfondir les problèmes et de les comprendre pour les expliquer.
En même temps il se lança dans un curieux travail en illustrant de dix dessins originaux, tous différents, douze exemplaires de « l’Après-Midi d’un Faune ». C’est une œuvre très inspirée et très intéressante qui symbolise la tendance de Jacques Zwobada qui voulait à tout prix trouver son lyrisme à travers la nature. Il fit de même en sculpture et, jusqu’à la guerre, il travailla des bustes, des figures et des esquisses, mais là, il détruisit tout au fur et à mesure, dans la tristesse de ses insatisfactions successives. Il en arriva même à renoncer entièrement à la sculpture et, de 1939 à 1943, il ne fit que le buste d’un ami. En revanche, il dessinait, entassant dans sa surprenante mémoire toute sorte de visions d’ensemble ou de détail, de nus, d’arbres, de paysages. Il préparait, sans le savoir, l’arsenal dont il aurait bientôt besoin, le dictionnaire de ses formes.
Qu’il en fut conscient ou non, il était temps pour lui de briser le double cercle vicieux dans lequel il était enfermé. En effet : d’une part il était d’une nature sensuelle, presque érotique, et avec cela fort timide, sauf sur le plan de son art. Ceci l’amenait à ne plus détacher la forme de son potentiel et à la tenir au niveau de sa recherche sans se laisser emporter dans l’aveugle tourbillon sentimental qui peut entraîner l’artiste dans le monde où tout se confond.
D’autre part, il continuait à ne pouvoir trouver de solution d’accord entre son lyrisme et son goût pour le classicisme.
D’il se trouvait ainsi ligoté par l’ambition de son inspiration, c’est qu’il n’avait jamais rencontré rien ni personne qui fut à l’échelle de son art, jusqu’au jour où, en 1942, il se trouva en face d’Antonia Fiermonte. Ses tourments stériles s’évanouirent pour laisser place à des tourments humains et il comprit que ses malheurs, sa présence sur terre, ses œuvres, n’étaient qu’une longue attente de cette rencontre. Il ne s’agissait plus pour lui d’être un artiste mais de parler, de plaire à Antonia. Le mot amour est bien petit pour évoquer le sentiment qu’ils partagèrent et vécurent. Je pense que pour Jacques Zwobada elle fut d’abord comme un archange qui lui aurait ouvert les portes de sa cellule obscure pour le mener dans le pays de ses rêves. Au moment où il allait sombrer dans le découragement, elle lui redonna le moyen de recréer son univers. C’est elle qui, du premier coup, lui permit d’échapper à l’esthétisme qui le guettait et dont il aurait mis des années à s’affranchir. Elle l’a fait avec l’habileté que lui dictait son intelligence et son amour. Elle avait pour l’intégrité de l’art, une passion pleine de rigueur. Son extrême sensibilité lui permettait d’avoir une perception instinctive et directe des plus secrètes expressions et son caractère la poussait à l’intransigeance. Sa finesse lui donnait une force dominatrice qui allait de pair avec une grande douceur. Elle s’employa à aider Jacques Zwobada à retrouver en lui le chemin de son génie. Elle a été l’avertissement dont parle Proust lorsqu’il dit : « C’est au moment où tout semble perdu que l’avertissement arrive qui peut nous sauver ». Elle avait devant elle un homme inquiet mais têtu qui avait tant pensé, tant cherché, tant détruit des ses sculptures que c’est en lui d’abord qu’elle devait l’inciter à trouver les éléments de sa révolution. Elle fut plus qu’un avertissement. Elle épousa Jacques Zwobada et devint l’inspiratrice, la conscience, la vie même de son mari.
Ils partirent pour le Vénézuéla où il avait été détaché par le Ministère de l’Instruction Publique en qualité de Conseiller du Gouvernement et Professeur à l’École des Beaux-Arts de Caracas. Cette évasion devait procurer à l’artiste un dépaysement bénéfique. Sa femme et lui se trouvèrent dans des conditions paisibles favorables au travail comme à l’échange des pensées, et lorsque Antonia revint en France, avant lui, la solitude le poussa à des réflexions sur les rapports entre l’apparence des choses et leur réalité intérieure. Déjà avant de quitter Paris, il avait dessiné une frise dans laquelle, pour la première fois, il avait dû, pour satisfaire sa vision, renoncer à l’exactitude des mouvements du corps humain. Mais à l’inverse de ses inquiétudes d’autrefois, il savait maintenant qu‘au cours des heures de silence qu’il passait à Caracas il élaborait une nouvelle écriture plastique, plus proche de ses sensations.
Peu après son retour à Paris, se place les circonstances de ce que j’appellerai le franchissement de la dernière étape dans la recherche de son style. La Régie Renault lui commanda un grand dessin destiné à orner la salle d’honneur de l’usine de Billancourt. Il y alla plusieurs fois, traversant les ateliers, ébloui, terrifié, assourdi et abasourdi, si bien que ces spectacles inhumains, mirent en route son imagination. Il commença à esquisser sur ce thème sans trop s’occuper de savoir où était la frontière de ce que l’on appelle le figuratif. En fait la direction de Renault voulait autre chose et ne lui demanda de ne pas obéir à cette inspiration trop libre. Alors, Jacques Zwobada, des hauteurs de Meudon, fit un dessin géant des usines et du paysage jusqu’au delà de Paris, qui est un monument de beauté, de décision et de mouvement immobile. La postérité le jugera sans doute comme une œuvre maîtresse de notre temps.
Ce que la servitude du dessin commandé ne lui avait pas permis de faire, ne l’empêchait pas d’y penser et de se questionner. Tout en dessinant la nature, tout en ressentant l’émotion qu’elle fait toujours naître en lui, il éprouvait aussi un sentiment plus secret, plus exigeant, plus fort aussi un peu comme la vie intérieure qui transmet aux arbres les ordres qu’ont dictés les saisons. Pour lui, tout devint clair. Il comprit que son tempérament impulsif et imaginatif ne pouvait se libérer qu’en utilisant et ordonnant des formes qui ne seraient pas soumises à des disciplines préalables, mais qui pouvaient aussi bien être suggérées par la réalité qu’inventées par sa main. Il y vit, en même temps, le moyen de conquérir un monde mythique où ses aspirations, ses sentiments et son idéal s’exprimeraient simultanément. Il pouvait ainsi trouver les rapports entre les valeurs et les sonorités et satisfaire les recherches qui le hantaient depuis ses entretiens avec André Caplet et Debussy dans les sentiers du Bois de Boulogne.
Il touchait au rivage de la terre promise. Allait-il débarquer ? Ce fut, une fois encore, un hasard fortuit qui allait brusquer les choses.
Chez lui, à Fontenay, un soir de la même année, comme il parlait avec le peintre Maurice Estève de son impossibilité de concrétiser ce qu’il ressentait, celui-ci lui dit : « Quand tu dessines, fais-toi plaisir et ne pense pas à faire des chefs-d’œuvre ». Il décida alors de retrouver, avec ses moyens nouveaux, la volupté de la main sur les grandes surfaces de papier, de plonger dans des compositions où son tempérament serait libre de s’exprimer, libre de puiser aux sources élaborées de la nature, libre de trouver des rythmes graphiques qui satisfassent un esprit habité par la musique, libre enfin d’utiliser la lumière pour rendre sensible les multiples visages des choses et des êtres en créant une œuvre qui lui appartint.
Il se mit au travail et dessina le « Concerto sans musicien », grande fresque d’instruments de musique sans exécutant, où les instruments ne sont pas placés comme ils le seraient si les hommes les animaient mais plutôt, comme leurs contours l’exigent pour créer un rythme à la fois plastique et musical dans l’harmonie d’une graphisme sonore.
Aussitôt après, il retrouva son goût pour la sculpture et fit successivement Orphée, le Couple, les Lutteurs qui procèdent du même sentiment en restant proche d’un réalisme dont il allait de plus en plus se dégager. Il voulait désormais que sa sculpture fût « comme un œuf », qu’on puisse la voir de tous les côtés, sans faiblesses et sans monotonie. Il commença donc à trouver ses volumes, à créer des passages et à enrichir ses profils jusqu’à obtenir ces œuvres que vous connaissez.
C’est alors que se placent les années de bonheur qu’a connues Jacques Zwobada. Enfin maître de son métier, il travaillait avec confiance et il avait auprès de lui celle qui pouvait, seule, lui apporter la tranquillité heureuse de la vie. Ces années furent trop courtes. Antonia Fiermonte mourut à Rome en pleine jeunesse et elle est à jamais irremplaçable aux côtés de Jacques Zwobada. Mais son esprit est encore là, dans son œuvre. Cet esprit est vivant et Antonia Fiermonte, en raison de l’extrême lucidité de ses propos et de sa vision reste au sens des créations de son mari. Il élève autour d’elle, dans la paisible campagne romaine où elle repose, le monument qui reçoit tout ce qu’elle lui inspire.
Pour comprendre et aimer l’œuvre de Jacques Zwobada, il est bon d’avoir vu en quelques instants le chemin suivi par cet artiste qui n’a ni recherché, ni refusé les influences mais s’en est dégagé comme de costumes qui n’auraient pas être faits pour lui. Son attirance pour le classicisme l’a réconforté dans les heures d’inquiétude et lui a permis de faire ses admirables dessins de Rome dans lesquels on sent affleurer le calme bonheur humain que lui procurait la présence d’Antonia Fiermonte.
Mais il n’y avait pas, finalement, de classicisme ou de romantisme, de cubisme ou d’archaïsme qu’il ait pu emprunter pour dire ce qu’il a à dire.
Dans l’esprit de notre temps, en avance sur notre temps, il a inventé lui-même son écriture. Il y a mis à la fois la sincérité, l’ampleur et la puissance des sentiments. Il l’a composée de rigueur et de tendresse, si bien que l’œuvre et l’homme se confondent et se transmettent aux spectateurs qui en retrouvent l’émotion.
Espérant conquérir une place parmi les chercheurs et les explorateurs assidus de son art, il me disait récemment : « Je n’ai pas l’orgueil de mon œuvre, mais j’ai l’ambition d’en avoir un jour ».
Déjà, en contemplant ces formes inventées, bâties sur des réalités cachées, dépouillées ce tout ce qui est facile ou habile, je sens passer le souffle d’une œuvre prophétique.